for the English version, click here: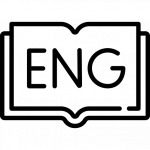
Quel rapport pouvons-nous établir entre Chat GPT et une soupe à la tomate jetée sur un Van Gogh ? Quelle invitation nous fait Proust, depuis l’époque analogique, pour dépasser les bruits insignifiants de Twitter ? Quelles leçons pouvons-nous tirer, à la fois des disruptions présentes et des grilles de lecture passées, pour décoder, recoder et dépasser le trou noir numérique contemporain ? Tentons quelques exercices d’agencements improbables.
Si on ne manque pas de communication, mais de création, comme le soulignaient Deleuze et Guattari, et comme je le démontrais dans le contexte du Web dans cet article, c’est que l’on manque d’espaces aux marges, libérés de l’impératif de l’utilité et de la quantifiabilité. Des lieux favorables à des « machinations » désirantes, productrices de nouveautés. Comment imaginer un tel cadre au sein du numérique ? Quels rapports entretenir avec les automatisations algorithmiques et les développements de l’intelligence artificielle, qui nous amènent à repenser la place et le rôle de l’esprit humain en tant que tel ? Dans notre époque d’absence d’horizon, quel pari stratégique pouvons-nous mener ?
Le numérique n’est pas un ensemble d’outils, mais bien notre culture-même. Le monde dans lequel nous vivons, comme l’explique Marcelo Vitali-Rosati – ou dans lequel nous essayons, malgré tout, de vivre. La rapidité de ses métamorphoses et l’opacité, la complexité de son fonctionnement le rend, pour la plupart d’entre nous, bluffant, sinon « magique ». Sauf que ses conséquences dépassent de loin la simple représentation de tours de magie, au cirque ou ailleurs. Le numérique nous trans-forme. Il encadre notre action, standardise la pensée.
La magie envoûtante et aveugle du numérique actuel peut être, avec un effort d’imagination et la volonté d’une réappropriation, renversée en une nouvelle forme de techno-magie, non plus illusionniste, mais participative, imaginative – éminemment relationnelle. C’est le défi qui se pose avec le développement d’intelligences artificielles, comme celles d’OpenAI.
Il s’agira pour nous d’entrevoir comment dépasser notre situation de « extinction internet », que décrit Geert Lovink – comme absence de possibilité, absence d’imagination suivant la capture du web et de ses potentialités par les plateformes. L’enjeu est médiatique, cependant il ne peut se repenser sans l’appui de concepts renouvelés et sans une analyse précise des fonctionnements algorithmiques de nos nouveaux « outils ».
Les Codes, les Désirs et leurs Agencements Créatifs
Dans L’Anti-Œdipe, Deleuze et Guattari désignent les codes comme l’ensemble des règles et des normes qui encadrent et organisent la circulation des flux (ces derniers consistants, de manière générale, en tout ce qui circule – y compris le désir). Tandis que la plupart des sociétés ont codé les flux pour mieux les canaliser, le capitalisme se distingue selon eux par son refus des codes et son extrême souplesse, comme le résume Benjamin Nitzer.
Il s’agit de me réapproprier cette idée de « code », dans un contexte différent, en l’appliquant littéralement au codage de nos supports numériques. Ainsi, décoder désignera l’acte de décoder ce qui ne peut, ou ne doit, être réduit à un calcul informatique, tandis que recoder désignera la réécriture de nos espaces numériques. Je le fais dans un sens proche de celui de Lawrence Lessig et de sa formule « code is law » – c’est-à-dire, où le code informatique peut protéger des valeurs, autant qu’en ignorer d’autres. Le numérique étant devenu le support de la majorité des flux dont parle D&G, le code doit aujourd’hui être pensé doublement comme norme et comme inscription informatique : les deux se croisant.
Nous retiendrons notamment la conception du désir développée dans l’Anti-Œdipe : un désir qui, plutôt que combler des manques, produit des agencements, des couplages de l’existant ; plutôt que de rester dans le fantasme, investit le champ social et le marque de différences. À partir du moment où nous concevons l’inconscient comme une usine, plutôt que comme théâtre – comme nous invitent à le faire D&G – le désir devient créateur et ainsi révolutionnaire.1Comme très bien expliqué par Benjamin Nitzer encore, dans le premier article de sa série autour du livre Il devient à même de décoder et recoder, à la fois les flux qui traversent notre société, mais aussi le numérique, en tant que support hégémonique de ces flux.
Ces notions étant posées, nous pouvons commencer à nous pencher sur ce qui constitue le processus créatif : une question qui nourrit un grand nombre des débats et critiques suscitées par l’apparition de Chat-GPT, Dalle-E, et autres modèles « génératifs ». Dans ces débats, certains en viennent à mystifier cette faculté, tandis que d’autres la réduisent grossièrement, comme l’a fait Sam Altman, le CEO d’OpenAI, dans ce tweet assez révélateur :

Figure 1 Tweet de Sam Altman le 04 décembre 2022, en réponse à ce papier
Tous perroquets ? Explorons quelques pistes qui nous permettraient de ne pas réduire l’intégralité de la vie de l’esprit – déjà bien endommagée par le consumer capitalism, puis les feeds de Meta ou de TikTok – à un calcul probabiliste.
Je propose de redéfinir le processus créatif au travers du concept d’Encyclopédie, que Claudio Paolucci emprunte à Umberto Eco (dont il hérite la pensée et la développe, à l’université de Bologne). Eco définit l’Encyclopédie comme « l’ensemble du déjà-dit, la bibliothèque des bibliothèques », soit l’ensemble des usages et des normes culturelles. Paolucci reprend cette idée pour décrire l’acte créatif (ou « l’énonciation ») comme un « ajout de soustractions » opéré sur cet ensemble.2Non sans l’appui de Deleuze et Guattari, dont nous trouvons une même logique dans la conclusion de l’essai Qu’est-ce que la Philosophie Selon lui, pour créer, le/la peintre ou l’écrivain(e), par exemple, ne doit pas remplir une surface blanche, « mais la vider, la nettoyer des stéréotypes encyclopédiques qui y palpitent ».3Voir, en français
Selon cette branche de la sémiotique – qui je crois, devrait bien davantage communiquer avec les programmes « d’humanités numériques » et « d’intelligence artificielle » – l’acte créatif consiste en un agencement entre le plan virtuel de cette « Encyclopédie » et l’acte réalisé, individué, différencié par le sujet. Le sujet lui-même émerge de cet acte, comme flux actualisé, recodé, de ce qui « palpite » dans l’Encyclopédie.
L’Encyclopédie, comme ensemble du déjà-dit, devient selon Paolucci un « sentier d’interprétation » que le désir créateur parcourt : non pas pour le répéter mais pour, au contraire, « y retirer de la matière ». Le désir créatif (les deux étant indissociable, si l’on s’en tient à la conception de l’Anti-Œdipe) n’a donc rien à voir avec la générativité de textes et d’images par Chat-GPT et Dall-E, entraînés sur un corpus « Encyclopédique » colossal de 300 milliards de mots pour le premier,4Bien que à prédominance anglo-saxonne et 12 millions d’image pour le second.
Sachant que ces systèmes consistent essentiellement en des calculs probabilistes et prédictifs, établis à partir des données sur lesquelles ils ont été entraînés, leurs outputs peuvent être persuasifs et même plutôt pertinents, pour répondre à nos requêtes. Cependant, nous sommes loin de « l’ajout de soustractions » dont parle Paolucci. Au contraire, nous sommes plutôt dans un ajout de stéréotypes, eux-mêmes « crawlés » automatiquement, et sans véritable sélection, à partir de données en libre accès dans l’Encyclopédie du Web.
Une première déduction que l’on peut faire de ces contrastes, c’est que le rôle de l’encyclopédiste contemporain est tout autre que celui des encyclopédistes des Lumières. Comme le dit Paolucci,5Dans le livre Struturalismo e Interpretazione, p. 186 si Diderot et d’Alembert avaient pour objectif, avec leur « Encyclopédie », de quadriller la surface de l’Encyclopédie de l’époque, d’en arboriser et d’en hiérarchiser les multiples connections, nous devons nous, à l’époque des IA génératives, opérer des synthèses entre ces éléments : en tisser des agencements improbables, des rapprochements imprévisibles.
Enlarge

L’imagination comme bricolage et comme renversement
Autrement dit, dans notre devenir encyclopédiste – c’est-à-dire créatif – nous devons imaginer, par-delà l’efficience de nos machines. Cela nous impose de plonger dans ce qui distingue les différentes facultés de l’esprit sur lesquelles travaillait Kant (entendement, raison, imagination, intuition, sensibilité), comme l’a fait Brice Roy dans sa thèse, et de les réinterpréter face aux facultés des IA.
Tentons un bref résumé des facultés qui nous importent ici. La sensibilité est « la faculté qui présente à l’esprit le divers du donné », tandis que l’entendement est « la faculté qui fournit les règles où les catégories à suivre, sans lesquelles il ne saurait y avoir d’intelligence du donné ». Jusqu’à là, nous pouvons automatiser en partie ces fonctions, par la récolte de données d’une part, et la prescription de catégories d’autre part, par des algorithmes.6Bien que cette automatisation partielle soit de nature différente : la « vision » de la machine ne correspondant en rien à la perception humaine (comme noté avec soin par Jordi Viader) De son côté, l’imagination est « la faculté qui va se saisir […] du divers donné et en faire une synthèse ». Elle « va assurer la mise en liaison de ce divers », en commençant par « parcourir et sélectionner dans la diversité du donné ».7Toutes ces citations sont tirées de la partie « Du caractère pratique de l’imagination », p. 99 – p. 114 de la thèse de Brice Roy, que nous avons collectivement lu et annoté dans le cadre d’un groupe de l’AAGT-Ars Industrialis, à l’initiative de Riwad Salim C’est là que les choses se compliquent. Il semble que les modèles de deep learning sont capables d’imagination, lorsqu’en réponse à nos requêtes, ils « parcourent » le divers de leurs données pour en sélectionner quelques-unes, et nous en retournent une combinaison, quelques fois très bizarre :
Enlarge

Cependant, pouvons-nous parler d’imagination lorsque cette sélection est dépourvue de sens, d’histoire, d’affects ? « Aucune émotion, aucune prégnance, aucun sens n’aide la machine à sélectionner ‘ce qui compte’ », comme l’explique Giuseppe Longo dans cet excellent entretien. En effet, la manière dont ces « réseaux de neurones » pensent, nous dit James Bridle, est « essentiellement inhumaine », ces réseaux n’ayant pas nos corps.
L’imagination, c’est une sélection - et donc une exclusion – qui consiste en une évaluation incorporée, nous dit Giuseppe Longo8Giuseppe est mathématicien et directeur de recherche en Épistémologie au CNRS. Voir sa page. Cela ne peut être réduit à un calcul arithmétique, aussi complexe qu’il soit. Quant à la synthèse opérée par l’imagination, elle est fondamentalement interprétative, soit le fruit d’une « convergence critique d’affects », comme l’expliquait Stiegler dans ce papier en anglais – ce qui exclut également ces agents sans corps et émotions humaines (et ce qui nous invite à relire Spinoza).
Ces bases philosophico-scientifiques concernant l’imagination étant posées, notre question peut se poser sur un autre plan, plus explicitement politique : comment protéger cette production imaginative, incorporée, des calculs ? Voir même : comment nos imaginations peuvent-elles s’appuyer sur le calcul, plutôt qu’y être réduites ? En 2020, Stiegler posait que l’improbable, à l’ère de l’hégémonie des calculs de probabilités, c’est la diversité.9Texte « Noodiversité, Technodiversité », écrit en printemps 2020 et non publié en Français, dont la traduction en Anglais par Dan Ross est vaguement accessible ici Trois ans plus tard, nous sentons et constatons plus que jamais « l’élimination systémique de la diversité » en cours, à commencer par celle de nos imaginations.
C’est dans cette optique de diversification que je voudrais faire un rapide éloge de la figure du bricoleur ou de la bricoleuse, comme l’a fait Brice Roy, car elle s’inscrit aux antipodes de cette calculabilité intégrale qui standardise l’imagination. Comme il l’écrit, l’inventivité du bricoleur tient à sa « capacité à s’émanciper des prescriptions de l’entendement, c’est-à-dire d’une part à les enjamber, au mépris de ce qui est dit possible ou permis, et d’autre part à détourner ces mêmes règles pour les utiliser de manière inappropriée. »
La particularité de l’invention bricolée, explique-t-il, « c’est d’être composée de ‘bric et de broc’, c’est-à-dire d’éléments marqués par une forte hétérogénéité et que rien ne prédestinait à être maintenus ensemble ». Imaginer, c’est bricoler, et bricoler, c’est tenir-ensemble. L’imagination est donc éminemment pratique, plutôt que fantaisiste : sa synthèse « présuppose un maintenir, c’est-à-dire l’exercice répété, dans la durée, de ce qui évite aux éléments de se disperser ». Plutôt que de savoir si ce qui est mis en œuvre « entre en cohérence avec des principes établis », ce qui compte c’est si cela fonctionne, nous dit Roy – et au-delà de cette fonctionnalité, ajoutons, si cela fait sens.
Bricolages inappropriés,10Plutôt que bricolages prescrits par des règles, ou bricolages aléatoires ajouts de soustractions … nos IA en sont structurellement incapables, et pourtant ce sont ces mêmes gestes qui composent le processus créatif et l’imagination – qui amènent à ce qui, pour nous humains, fait sens. Outre ces gestes, une autre source de l’imagination non moins fondamentale doit être évoquée ici, s’il s’agit de dépasser notre époque d’absence d’imagination : celle que Nietzsche décrit métaphoriquement comme celle du « lion », dans Ainsi parlait Zarathoustra.
Rien de mieux pour illustrer cette source de l’imagination que les actions récentes d’activistes dans les musées, dont l’une à base de soupe à la tomate et de Van Gogh :
Enlarge

« Créer des valeurs nouvelles – le lion lui-même n’en est pas encore capable, – mais conquérir la liberté pour des créations nouvelles – voilà ce que peut la puissance du lion », écrivais Nietzsche.11Dans la partie « les trois métamorphoses » d’Ainsi parlait Zaratouhstra (merci Oscar pour le cadeau <3) Cette force propulsive, nous la retrouvons aujourd’hui dans ce type de gestes, qui nous invitent à « repenser la notion-même de valeur culturelle », comme l’explique Anna Longo sur AOC : il peuvent être vu comme « un appel lancé aux artistes et aux véritables créateurs à imaginer un nouveau monde ».
Si je mentionne Nietzsche, c’est qu’il semble si bien répondre aux commentateurs scandalisés de ces actions : « Voyez les bons et les justes ! Qui haïssent-ils le plus ? Celui qui brise la table de leurs valeurs, le destructeur, le criminel – mais celui-là c’est le créateur. » Pour Nietzsche, les créatrices et créateurs, ce sont « ceux qui inscrivent des valeurs neuves sur des tables neuves ». Et en effet, s’il y a transvaluation des valeurs à faire, c’est-à-dire un renversement de toutes les valeurs à opérer – et c’est ce à quoi nous convoque les multiples enjeux écologiques, technologiques, politiques actuels – cela ne peut se faire sans cet effort surhumain, d’apparence destructeur. Tout est à redéfinir, et ce mouvement de redéfinition ne peut provenir de nos IA, qui nous cantonnent plutôt aux tables des vieilles valeurs.
Lecture et Écriture Numérique
Je continue mon bricolage conceptuel pour en venir plus précisément à notre culture numérique, en tant que telle. Comment entrevoir une irruption du désir dans le numérique, dans sa lecture autant que dans (la possibilité ouverte de) son écriture ?
Pour commencer à répondre à cette question, je voudrais convoquer Proust. Dans un texte intitulé Sur la lecture, il fait de magnifiques digressions sur les conditions d’une lecture propice. Ses préceptes me semblent toujours s’appliquer, pour nos lectures numériques :
« Tant que la lecture est pour nous l'initiatrice dont les clefs magiques nous ouvrent au fond de nous-mêmes la porte des demeures où nous n'aurions pas su pénétrer, son rôle dans notre vie est salutaire. Il devient dangereux au contraire quand, au lieu de nous éveiller à la vie personnelle de l'esprit, la lecture tend à se substituer à elle, quand la vérité ne nous apparaît plus comme un idéal que nous ne pouvons réaliser que par le progrès intime de notre pensée et par l'effort de notre cœur, mais comme une chose matérielle, déposée entre les feuillets des livres comme un miel tout préparé par les autres et que nous n'avons qu'à prendre la peine d'atteindre sur les rayons des bibliothèques et de déguster ensuite passivement dans un parfait repos de corps et d'esprit. » Marcel Proust
Cette longue citation, il la résume plus tard comme « la lecture est au seuil de la vie spirituelle ; elle peut nous y introduire : elle ne la constitue pas. » Le parallèle avec notre époque est pour moi frappant, nous qui sommes tentés de déléguer nos esprits à des fils Twitter et la vérité à Chat-GPT. Bien que ces plateformes soient loin, très loin des « grands et merveilleux caractères des beaux livres » dont Proust parle. Ce pourquoi il nous faut absolument recommencer à désirer des espaces de lecture en ligne qui soient alternatifs à ces modèles, de manière à y cultiver du désir.
Pour Proust, évidemment, la lecture, l’imagination et le désir forment un trouple : « nous sentons très bien que notre sagesse commence où celle de l'auteur finit, et nous voudrions qu'il nous donnât des réponses, quand tout ce qu'il peut faire est de nous donner des désirs. » Comment retranscrire, dans le numérique, la vision Proustienne de la lecture - cette « impulsion d'un autre esprit, mais reçue au sein de la solitude », cette « imagination [qui] s’exalte en se sentant plongée au sein du non-moi » ? Est-ce encore possible ?
Certes, il y a du travail. Nous pourrions dire a priori que l’effort devrait être davantage « culturel » et dans nos pratiques, qu’il ne devrait être « technologique » – bien que le design d’interfaces appropriées soit crucial. D’autant que nous pourrions définir avec Stiegler la lecture comme ce « lieu où l’on prend son temps, ou il y a un retard essentiel entre saisie et réception ». C’est aux antipodes de ce que représente Twitter et son feed infernal, et c’est à se demander si nous pouvons vraiment parler de lecture, lorsque l’on scroll.
Une autre pratique constitutive de la lecture qui est mise en danger par la configuration actuelle du numérique est l’interprétation. Toujours selon ce texte de Stiegler publié en 1990, il faudrait « éliminer les excès de l’exactitude [de nos machines] pour y frayer un chemin, y ouvrir une perspective », en corrigeant celle-ci par la « réintroduction de la lecture comme défaillance ». J’aime bien ce point de vue, un peu polémique, de la lecture comme défaillance. Que veut dire Stiegler par-là exactement ? Défaillance, pour lui, n’est autre que « l’impératif de décider (d’interpréter) », décisions-interprétations qui sont toujours, dans une certaine mesure, infidèle à ce qui est interprété, hérétique : hors du cadre de l’exactitude et de ce qui est couramment admis.
Affirmer cela, c’est revendiquer son libre droit à une interprétation inexacte, comme droit humain fondamental dans notre cohabitation avec les machines programmées avec exactitude. Cela implique une vision toute autre de la vérité, une vision plurivoque, qui nous incombe de remonter jusqu’à Platon pour mieux ‘le tuer’.12Comme le souligne Stiegler dans De la misère symbolique, p. 211 : « contrairement à ce que voudrait faire croire Platon, qui comprend la vérité comme univocité et exactitude (orthotès) […] la participation est une interprétation (hermeneai), une activité par laquelle le logos, loin de se limiter à un sens, ouvre des possibilités indéfinies d’interprétation (des masques de la consistance de ce qui est interprété : le texte) »
Enlarge

Au travers de l’interprétation, la lecture est aussi une écriture, si l’on suit Stiegler. Nous avons besoin de cette possibilité de l’écriture dans la lecture, sans quoi cela contribue à une perte du sentiment-même d’exister. C’est pourquoi, il pose qu’une véritable lecture de la mémoire numérique serait « fondée dans la possibilité ouverte de son écriture », comme elle l’était dans la mémoire analogique – et c’est bien cette possibilité ouverte de l’écriture dans la lecture numérique que j’aimerais investiguer, dans le cadre de mes propres recherches. Sans trop rentrer dans les détails, une telle possibilité aurait pour principes :
- De se raccorder à des groupes partageant des intérêts en commun, groupes qui se tiendraient à l’écart des projecteurs éblouissant des plateformes. Ici, il semble pertinent d’évoquer le livre Survivance des lucioles de Georges Didi-Huberman, qui commente les lucioles de Pasolini. Celles-ci existent toujours, en « survivance », hors des lumières de la société du spectacle. Nietzsche avait par ailleurs déjà bien saisi l’enjeu avant l’avènement d’une telle société, lorsqu’il écrivait « je ne veux plus désormais parler à la foule ; c’est la dernière fois que j’ai parlé à un mort […] Ce n’est pas à la foule que Zarathoustra doit parler mais à des compagnons ». Plutôt que travailler à une nouvelle plateforme, nous devrions constituer des réseaux de groupes de compagnons.
- De favoriser par son design des discussions de parrhésiastes, c’est-à-dire d’efforts de vérité, plutôt que de simples réactions, qu’elles soient flatteuses ou moqueuses. Il s’agirait de dépasser les limites du « freedom of speech » cher aux Américains, dont presque 20 ans de Twitter nous a plus que montré l’insuffisance, et s’inspirer de la parrhèsia qu’en fait Geert Lovink au travers d’Extinction Internet:
- D'introduire dans son cadre un au-delà de l’efficience des calculs et de la quantifiabilité, en commençant par favoriser ce que Stiegler conceptualisait comme « consistances » : soit des idéalités, des projections dans l’avenir qui n’existent qu’entre les esprits, qui relèvent du « rêve » ou de la fiction, mais qui sont cependant indispensables au désir de vivre ensemble.13Ici, il faut relire ce qu’il en disait dans Aimer, s’aimer, nous aimer : « désir individuel tel qu’il est indissociable d’un désir du nous, et de nous, indissociable d’un désir d’un nous, de la possibilité de dire nous » (p. 27)
Il va sans dire, ces trois principes se complémentent dans leurs articulations. À quoi pourrait ressembler cette « possibilité ouverte de l’écriture », dans son processus et sa réalisation, au travers de schémas de pensées numériques et de mécanismes algorithmiques ? Une fois encore, sans trop les développer, voici quelques pistes sur lesquelles je compte travailler :
- L'écriture peut être considérée comme un réagencement, une juxtaposition de matériaux préconstitués, plutôt qu’une invention ex nihilo. Cet article lui-même consiste en une grande et hasardeuse juxtaposition. À partir de cette prémisse, nous pouvons envisager de nouvelles manières d’écrire via le numérique – par exemple, par un réagencement d’annotations faites sur d’autres textes, comme nous l’avons expérimenté avec Esther Haberland (avec les outils Hypothesis et Etherpad).14Voir ce compte-rendu, co-rédigé avec Maude Durbecker et Camille Lizop, de la séance de l’atelier de lecture Organoesis, autour du chapitre « La destruction de la faculté de rêver » du livre La Société Automatique Des coupures que nous pouvons faire lors de la lecture ou du parcours de textes peuvent être recousues dans des formes d’écritures-collages. Cette pratique émergente de lecture et d’écriture brouille la frontière entre les deux, et problématise l’idée-même d’un(e) « auteur ».15Poursuivant un mouvement déjà bien entamé par Michel Foucault et d’autres S’il est vrai que « l’essence » de l’auteur est remise en cause par l’écriture collaborative, cela peut mettre en valeur une autre idée du texte, comme espace commun ou « réservoir transindividuel », dans les mots de Tiziana Mancinelli co-écrivant son texte avec le collectif Ippolita.16Dans une contribution au livre Unlike Us Reader porté et publié en 2012 par l’Institute of Network Cultures
- « L'écriture computationnelle », une écriture qui s'inspire de la programmation, constitue une telle juxtaposition et nous rappelle que l'écriture est un acte de tissage : une réalisation d'assemblages. Elle établit des liens entre différents fragments de code ou de texte, des fonctions qui sont copiées-collées et rassemblées de manière singulière pour servir un objectif. Ce mode de lecture et d'écriture est un mode de pensée en soi : un « imaginaire du code », selon les termes de Winnie Soon et Geoff Cox, qui tend à reconfigurer les schémas de pensée humains en tant que tels. De manière similaire, l'hypertexte reconfigure nos manières de pensées au travers d'une lecture et écriture qui se permet de devenir multidirectionnelle, plutôt que linéaire et à la recherche d'une fin précise. Dans sa navigation de l'océan du Web, la pensée hypertextuelle s'autorise la dérive
- Enfin, puisque l’on parle du support numérique, l’écriture peut et doit se faire au sein des algorithmes-mêmes qui orientent les contenus. C’est-à-dire dans ce qui visibilise certains et invisibilise d’autres, ce qui permet ou contraint leur circulation. Il faut bien saisir ici que les anciens « gardiens du débat » (journalistes, éditeurs, académiques, …) perdent peu à peu leur monopole de filtrage du débat, avec l’essor du « web social », mais que cependant, « loin de disparaître, la sélectivité s’est cependant reconfigurée à travers le tri algorithmique », comme cela est expliqué dans cet article à partir des travaux de Dominique Cardon.
Restons-en à ces quelques pistes pour le moment. On peut résumer cette tentative comme un « provocatype »,17Comme en parle Geert Lovink dans Extinction Internet, pour envisager un dépassement des prototypes habituels, dont l’innovation n’est qu’incrémentale à contre-courant des conceptions dominantes du numérique et de l’automatisation, de la lecture et de l’écriture, de la communauté et de la discussion. L’enjeu plus médiatique est de dépasser notre dépendance aux médias traditionnels décriée par Serge Halimi et Pierre Rimbert dans le Monde Diplomatique (mais dont ils ont négligé le contre-pouvoir médiatique que peut être le numérique, même dans l’exemple qu’ils prennent du référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005, où ils ont totalement dénié le rôle fondamental des forums naissants sur le Web dans la mobilisation pour le « non »18Sur cette histoire, écouter ce podcast https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-code-a-change/29-mai-2005-le-jour-ou-les-politiques-ont-pris-internet-au-serieux-6391550).
Régime et récit techno-magique
Il nous faut rattacher toutes ces pistes et principes à un récit, un imaginaire plus large. Quelque chose de propulsif pour de telles initiatives, capables de reconfigurer le numérique et sa pratique. Dans quelle narration peuvent-elles s’inscrire ?
Dans Out of the Wreckage, Georges Monbiot nous rappelait la nécessité, humaine et stratégique, de forger des histoires, qui nous permettent de naviguer dans le monde et d’en interpréter les informations diverses, contradictoires. Des narratifs qui puissent résonner avec notre actualité, tout autant que nos désirs et projections. S’il est vrai que le narratif néolibéral a perdu son compas et sa force de persuasion, comme nous le montrions dans ce billet de blog ou encore dans celui-ci, nous devons le remplacer par un autre narratif, car « la seule chose qui peut remplacer une histoire est une histoire », comme le dit Monbiot (et comme Geert Lovink en reprend les mots, pour poser l’enjeu en termes d’alternatives aux plateformes).
Voici un début de récit que je propose : nous vivons dans un régime techno-magique.
Le mot « magique » revient souvent, lorsque l’on parle de ce que sont capables les « intelligences artificielles ». En réalité, cela date des années 70. Plus récemment, Tristan Harris (ex-Google) a écrit un article pour expliquer en quoi son travail en tant que « Design Ethicist » chez Google (c’est-à-dire, par rapport à la soi-disant « éthique de la persuasion » des programmes de Google) consistait en un travail de magicien.
« Je suis un expert sur comment la technologie détourne nos vulnérabilités psychologiques. J’ai appris à penser ainsi lorsque j’étais magicien », raconte-t-il :
Enlarge

« Les magiciens commencent par chercher des angles morts, des vulnérabilités et des limites dans les perceptions des gens, de manière à ce qu’ils puissent influencer ce que les gens font sans qu’eux-mêmes le réalise. Et c’est exactement ce que les designers de produits font à vos cerveaux. Ils jouent avec vos vulnérabilités psychologiques (consciemment et inconsciemment), contre vous dans la course pour attraper votre attention. » La suite de son article rentre plus précisément dans ces tours de magie numériques made in California.
De l’autre côté, celui des « utilisateurs » (plutôt des utilisés, si on en croit Harris), apparaît une forme de « pensée magique », celle que Serge Abiteboul et Jean Cattan dénonce comme consistant à « tout accepter sans réfléchir, ou tout refuser en bloc ». Selon eux, nous pourrions pourtant sortir de cette logique manichéenne, avec « une petite connaissance du monde des algorithmes et des logiciels ». Celle-ci nous permettrait de comprendre « qu’il n’y a aucune magie en eux, qu’ils ont été conçus par des humains, avec leurs limites ».
Rien ne va de soi dans les programmes. Dans quelle mesure voulons-nous voir ce qui se passe en coulisse de ces tours de magie ? Est-ce que l’on veut saisir ces techniques, ou préférons-nous que cela reste pour nous une forme de magie ? C’est ce que Megan Graber demandait dès 2012 dans l’article « Americans Love Google ! Americans hate google ! ».
La question se pose toujours, et d’autant plus avec l’importance croissante que prend le « cloud », que l’on peut comprendre comme une manière magique de ne pas avoir à penser aux serveurs et leur maintenance, ainsi que tous les enjeux de pouvoirs qui s’y jouent. Lorsque l’on dépose des contenus sur Google Drive ou des vidéos sur YouTube, par exemple, nous déléguons à la méga-compagnie Alphabet nos mémoires (qu’ils peuvent effacer à tout moment, et dont ils manipulent les données contre nous), en échanges d’interfaces simples et de systèmes qui ne beuguent quasiment jamais. Cette habitude du « cloud thinking », nous en parlions à l’occasion d’un événement de l’INC, dont j’ai fait un compte-rendu ici.
Aujourd’hui, c’est Chat-GPT qui est au centre de toutes les attentions. Mais si l’on creuse derrière ses tours de magie, on y voit ni plus ni moins qu’un système très sophistiqué de « baratinage », de tromperie. Chat-GPT se fout de la vérité : Il est dans le bullshit, comme le sont la plupart de nos politiciens par ailleurs. C’est ce que Monsieur Phi expliquait très bien dans cette vidéo :
Bien sûr nous pourrions donner d’autres exemples, comme celui des sites de rencontres qui présentent les calculs froids de leurs algorithmes comme ayant une dimension magique, permettant de rencontrer l’inespéré, le « destin ».19Voir Mektoube La complexité magique, insaisissable de l’amour rencontre ici celle des algorithmes, comme bien formulé par Vitali Rosati.20Dans son livre On Editorialization, accessible ici
Voilà pourquoi nous sommes dans un régime techno-magique, et comme a pu l’écrire Vincenzo Susca dans un livre en italien intitulé Tecnomagia. Selon ce chercheur, la techno-magie consiste en une « aliénation volontaire et globalement inconsciente du corps social » par les plateformes comme Netflix et TikTok, une « esthétique du mal-être » qui nous fait rentrer collectivement, et de manière accélérée depuis le COVID-19, dans une sorte de « danse macabre ». À partir de la notion de totémisme, Susca éclaircit les liens qui ont toujours existé entre religion, technique et magie.
Cependant, il me semble que le phénomène dont parle Susca par rapport au numérique – et de fait, tous les phénomènes que je viens d’évoquer – tout cela relève davantage de ce que l’on pourrait appeler un techno-illusionnisme. Si je pose cela, c’est parce que j’estime que l’on pourrait garder dans l’idée de magie, quelque chose qui relève d’un espace ouvert des possibilités, quelque chose d’improbable et d’incalculable, une part de mystère. Quand bien même la techno-illusion se présente comme techno-magie, nous voyons bien qu’il s’agit plutôt d’une forme d’envoûtement et d’emprise largement inconsciente, une tentative de détermination et d’accaparement de nos attentions.
J’en reviens à cette nécessité d’un récit propulsif. Si « Extinction Internet marque la fin d’une époque d’imagination collective » et d’arrangements techno-sociaux alternatifs, comme le déclare Geert Lovink, la techno-magie pourrait désigner, quant à elle, « une énergie libérée pour créer de nouveaux débuts ». Cette « machine qui écrit » dont parle Franco Berardi, qui a été mise en motion durant la période COVID-19 et dont la visée est ni plus ni moins que de « réécrire le logiciel poétique et computationnel des interactions sociales ».
La véritable techno-magie peut être ce souffle créatif inédit émergeant de nos circonstances bouchées. Quand bien même l’extinction serait déjà jouée d’avance – celle de la biosphère comme celle d’Internet – nous pouvons encore émettre nos plus belles danses et celles-ci n’ont pas à être macabres, contrairement à ce qu’en pense Susca. Ceci est un point de vue générationnel : ne pas s’en tenir à du macabre. Il y de la vie permise par la mort et dans celle-ci : c’est une question de rapport, de comment nous l’habitons. Ne soyons pas trop absolutistes sur l’avenir. Voici une histoire qui reste à écrire par les nouvelles générations.
Il nous faut générer des rêves au sein même du cauchemar du troisième inconscient décrit par Berardi ; un nouvel horizon du désir, au sein même de la probabilité de l’extinction. Nous pouvons le faire par un nouveau mouvement de l’imagination, lui-même techno-assisté (il n’y a pas d’imagination sans techniques d’imagination). Ce mouvement, imaginatif et désirant, peut être pensé comme danse. Un mouvement qui vient du corps, et qui vise le corps. Au-delà du désir comme représentation théâtrale de Freud, et du désir comme production à l’usine de Deleuze et Guattari, le désir comme mouvement de danse évoque quelque chose d’à la fois insolent et réparateur : un désir plus proche de ce qui constitue notre sentiment d’exister, et qui peut casser. En outre, si la perception érotique se voit de plus en plus remplacée par une perception informatique, comme l’affirme toujours Berardi, la danse, jamais véritablement seule, nous invite à cette conjonction entre les corps dont on peut tendre à oublier l’inexactitude, l’ambiguïté, l’impertinence.
Voilà un début de récit pour issue techno-magique au régime techno-illusionniste. Une narration affectivo-politique lucide et désirable pour les années 2020, nous faisant entrevoir une issue techno-émancipatrice au techno-féodalisme.
Enlarge

Plus concrètement, la techno-magie pourrait se constituer autour de technologies capables d’oublier – oubli essentiel pour être capable d’imaginer. Il faudrait pour cela travailler sur des bases de données alternatives qui, en plus de ne pas tout retenir à jamais, laissent une place ouverte à ce qui ne peut être encodé en elles. Qu’est-ce qui ne peut être encodé ? Les rapports – amoureux, rivaux, désirants – qui ne peuvent être substantifiées comme données. Par définition, un rapport ne peut être réduit à une substance : il s’agit d’un « incalculable », d’une forme de secret bien gardé, bien que partagé.
Il nous faut donc penser en termes Spinozistes, comme Yves Citton et Frédéric Lordon nous invitent à le faire – où les identités des individus et des objets deviennent elles-mêmes des rapports, ou plus exactement des « rapports de rapports ». Voici une forme de magie, si l’on reprend leurs mots : une « production relationnelle des rapports et des identités ». Une complexité et un mystère qui nous échappent, qui échappera à jamais aux automates. Si l’on n’affirme pas cette magie, nous nous laissons, de fait, illusionner par les dernières technologies de la Sillicon Valley, qui nous font croire que tout peut être réduit à leurs calculs. Aussi puissants (et surtout énergivores) qu’ils soient, ces calculs n’ont de rapports que de l’arithmétique.
Le récit techno-magique, qui reste à écrire, peut aussi être celui d’un agencement d’affects par la technologie et un recodage de ce qui nous fait partager des désirs communs. Si la vie politique est en effet, comme Citton et Lordon le disent, un ensemble de « phénomènes de composition et de propagation d’affects », il nous faut alors la recomposer à partir du contexte computationnel, aujourd’hui principal manipulateur de nos affects.
Notre contexte numérique favorise l’impuissance, dans la raison (avec l’arrivée de Chat-GPT) autant que dans l’action porteuse de sens (par son absorption dans des océans d’insignifiances, comme peut le favoriser Twitter). Il favorise aussi l’atomisation des individus, les réduisant le plus souvent à des profils. Une techno-magie apparaîtrait donc dans des espaces où se reconstitue une puissance de la multitude, où se recomposent nos affects et nos liens. Cet espace, aux bords, (ré)ouvrirait les vannes d’une circulation de cette puissance et serait ainsi à même de servir « l’alter-doctrine du choc » que Stiegler appelait durant ses derniers mois.21Voir par exemple ce séminaire
Les Bords et leurs Appuis
D’un point de vue mathématique et sémiotique, parler « d’espace numérique » est hors-propos, si l’on reprend les travaux de Giuseppe Longo et de Jean Lassègue. Selon le premier, « le numérique est né pour ne pas avoir à faire avec l’espace », car le codage numérique consiste essentiellement en une séquentialité arithmétique née de la crise de la géométrie Euclidienne. « Une manière de casser l’espace, c’est le codage linéaire du monde », me répondait-il à un questionnement que je lui avais posé, le 31 mars dernier. Selon lui, « les réseaux d’ordinateurs constituent un autre ‘espace’ que celui du vivant et de son action, un espace aux topologies et aux distances arbitraires. »22Pour plus de détails, lire le livre Le cauchemar de Prométhée, publié chez PUF ce mois-ci
Selon le second, il n’y a pas de continuité entre « l’espace vécu par les corps parlants que nous sommes [et] les lignes de codes […] qui relèvent d’une écriture détachée de tout rapport à l’espace ». Son diagnostic est méconnu, cependant il est lourd de conséquences : « c’est le différentiel entre l’espace vécu et le non-espace des lignes d’écriture informatique où se situe aujourd’hui le problème de la construction collective de sens ». C’est ainsi que ce chercheur relie la « crise de la décision » démocratique à une « délégation généralisée de la lecture et de l’écriture aux ordinateurs ».
Nonobstant ces considérations qui me semblent fondamentales, je veux tout de même, sur un plan plus stratégique et métaphorique, parler d’espace numérique, avec Marcelo Vitali-Rosati, quand bien même cet espace constituerait un autre espace avec ses propres règles. Comme ce dernier l’explique, l’espace peut aussi être pensé comme le résultat de relations entre sujets et objets : non pas quelque chose de stable et d’indépendant, mais de dynamique. Ces relations étant écrites, dans le medium numérique (les codes créant des dispositions entre différents « objets »), nous pouvons investiguer ces codes comme des interprétations particulières du monde et des manières de l’habiter.
Dans « l’espace numérique », tout objet est encodé – même les images, même les vidéos. Même nos actions sur le Web sont écrites : un click est inscrit sous forme de donnée dans plusieurs bases de données. ‘Dehors’ et ‘dedans’ ne fonctionnent pas de la même manière, car un même objet – un document collaboratif, par exemple – peut-être à plusieurs endroits à la fois, et il en va ainsi pour ‘centre’ et ‘périphérie’ (ce même document peut être au centre d’un forum de discussion et aux marges d’un échange d’emails). De même, le « texte social » dont parle Bob Stein met en évidence la façon dont les conversations en marge d'un texte sur le Web peuvent, dans certains arrangements numériques, devenir quelque chose de central à celui-ci.
La délimitation est inclusive plutôt qu’exclusive, donc, dans l’espace numérique, comme l’explique Vitali-Rosati, avec des sujets et des objets capables d’occuper plusieurs positions en même temps. Il existe bien des frontières sur le Web, sans quoi il ne pourrait fonctionner – mais elles sont poreuses. Le web est strié et lissé tout à la fois. L’espace est ainsi multiple, et il peut produire ainsi des sens multiples, en fractales. La désorientation induite de cette plurivocité, nous la retrouvons génialement exprimée dans le film Everything, everywhere, all at once, où le cinéma devient le messager idéal de ce ressenti collectif du « digital era » :
En politisant l’espace numérique ainsi, Vitali-Rosati politise cette dimension que je veux développer de positionnement – positionnement qui serait spécifique à cet espace qui n’en est pas véritablement un. La question de centre et de bords est une question de hiérarchie, dans l’espace physique : selon l’exemple de V-R, le fait que la cathédrale est au milieu de la ville signifie quelque chose, au moins à titre historique, sur l’organisation du pouvoir politique. D’où positionnons-nous par rapport au centre du pouvoir ? Une position qui me semble stratégique est celle des bords mais, comme nous l’avons vu, dans le numérique, ce même bord d’espace peut être le centre d’un autre.
C’est ici qu’il faut à nouveau faire appel aux machines désirantes de Deleuze et Guattari. En les lisant, je trouve cette citation qui s’applique très bien à ce que je veux élaborer : « Il se peut que les machines désirantes naissent dans les marges artificielles d'une société, bien qu'elles se développent tout autrement et ne ressemblent pas aux formes de leur naissance ». Un bord n’a pas vocation à rester au bord. Si « au centre il y a la machine du désir », l’enjeu serait, toujours en reprenant leurs mots, de développer « des expériences et des machinations qui la débordent de toutes parts ». Un peu comme les ronds-points des gilets jaunes, qui ont dé-bordé depuis la périphérie, le centre de la machine du pouvoir macroniste. Pour faire sens stratégiquement, le bord doit atteindre le centre. Nous pouvons penser cela comme un mouvement de reconquête, opéré par le désir.
Ces considérations peuvent sembler abstraites, excessivement conceptuelles, cependant elles renvoient à une manière de faire politique tout à fait concrète, quotidienne, immédiate. Les bords, numériques ou pas, peuvent être cet espace où l’on bricole en récupérant des matériaux produit par le système de pouvoir en place. Ils peuvent être cette approche, où plutôt que de rejeter entièrement l’efficience des calculs et des algorithmes, nous nous en servons pour favoriser un processus de diversification. Ou encore, servir de métaphore dans ce pari de sortir du capitalisme à travers le capitalisme numérique, aussi paradoxal que cela puisse sembler, en y introduisant de la techno-magie aux bords de ses techno-illusions. C’est ainsi que s’est constitué Wikipédia, qui n’a pas à rester l’exception du trou noir numérique.
En parlant de trou noir, il faut se rappeler des travaux de Stephen Hawking, qui ont montré comment les trous noirs ne font pas qu’absorber de l’énergie et de la matière. Ils émettent également des rayonnements, sur leurs bords. Les trous noirs sont pleins de paradoxes :
Enlarge

Les bords sont dans l’espace des corps dont parlent Longo et Lassègue, tout comme dans l’espace des rapports dont parle Vitali-Rosati. Ils nous encouragent à nous tenir à l’écart, comme principe moral,23Voir cette table ronde aux dialogues compliqués, sur la question de la désertion et de la bifurcation tout comme ils nous invitent à adopter, comme stratégie collective, une politique du décodage et du recodage des différents espaces qui nous transforment. Les bords nous tiennent dans un mouvement d’oscillation, de fluctuation.
Lorsque nous sommes sur les bords, nous nous tenons entre la désertion et la compromission – toujours de manière instable, fragile. Nous tentons de nous instrumenter, sans nous faire instrumentaliser. Nous sommes de véritables funambules, dans une forme de prouesse, aux bords de deux précipices, de deux vides.24Ou plutôt, comme me le suggère Somhack Limphakdy, « d'un côté, oui, nous sommes face au vide, mais de l'autre c'est le néant. Si dans les deux cas, nous sommes bien pris de vertige, le premier ouvre à l'indétermination même du vivant, tandis que le second se refermerait sur nous, détruisant le "possible" lui-même [...] c'est l'écueil qu'il nous faut éviter et donc face auquel nous devons prendre fermement position » (par email, le 17/04/23, en retour à ces lignes) Nous sommes un peu comme cette figure étrange, qui m’a été recrachée par le générateur artificiel d’images Dall-E, à qui j’ai donné l’instruction « un funambule sur une mer de digits dans un style cyberpunk » :
Enlarge
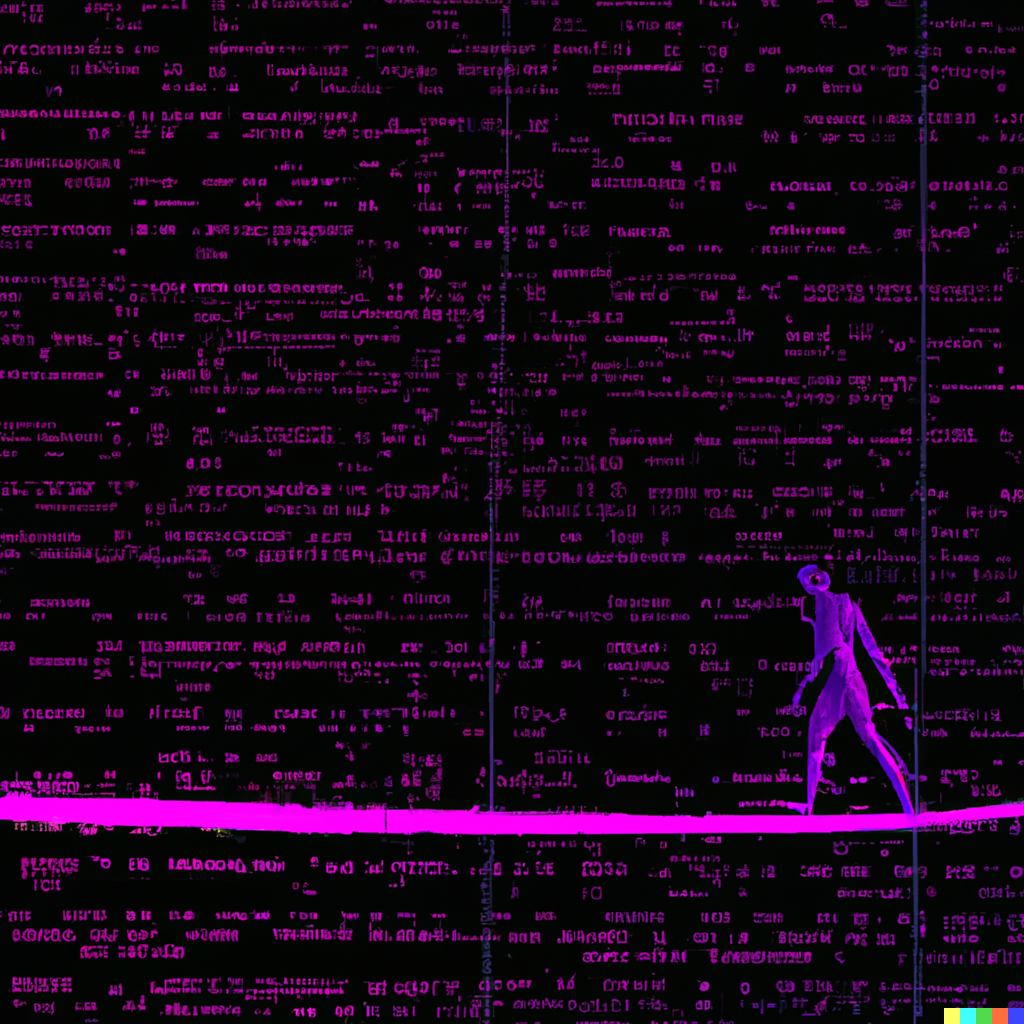
En réalité, pour que ce techno-funambule tienne, il va nous falloir quelques appuis institutionnels. Les bords doivent être nourris « de part en part » par le système, écrivait Stiegler. Il va nous falloir conquérir leurs conditions matérielles de possibilité et les revendiquer par la rue – comme le mouvement actuel en France, contre la réforme des retraites et le 49,3 (en réalité, de plus en plus contre Macron et son monde).
Comment généraliser le travail d’imagination créative dont je parlais au début, sans assise financière capable de nous libérer du temps ? Si le travail de l’emploi est pour nombre d’entre nous aliénant, un travail libéré de l’emploi serait à imposer au débat de la « réforme » des retraites, débat qui est loin d’être terminé. La retraite peut par ailleurs être vue comme une préfiguration de ce travail libéré, bien plus qu’un droit à la paresse (cependant que la paresse peut être très créative).
La nouvelle génération a le droit à sa forme de retraite, elle-aussi : celle, par exemple, du droit à l’échec. Notre contexte économique ne favorise pas ses prises de risques, manquant de plus en plus de formes de sécurités économiques capables d’absorber ses chutes. C’est pourtant à cette même génération que l’on demande de « sauver la planète », de sortir l’humanité du pétrin systémique dans lequel elle s’est – ou certains l’ont, c’est selon – poussé.
Il n’y a pas de bordures créatives et transitionnelles, comme Stiegler les a nommés, ou de productions désirantes libérées et débordantes, comme j’ai essayé de l’imaginer dans ce longform, si nous ne disposons pas de filet économique de sécurité – nous fournissant une stabilité et assurance matérielle nécessaire à la prise de liberté imaginative et désirante. C’est pourquoi il nous faut repenser le régime de la sécurité sociale, comme cette tribune écrite et signée par plusieurs membres de mon Association invite à le faire, en commençant par redéfinir, au-delà du PIB, les notions de « richesse » et de « valeur ».
Au travers de cet article, j’aurais tenté de dessiner une esquisse de dépassement de notre situation technologique et politique, qui n’a pour le moment d’horizon que l’extinction, à commencer par celle de la diversité en générale. Un parcours du funambule : celui du décodage et du recodage sans garantie de notre régime techno-social. Une voie cependant capable de susciter chez moi un désir, que j’espère pouvoir faire partagé.
—
Victor Chaix est actuellement étudiant en Master d’Humanités Numériques à l'Université de Bologne. Intéressé par la philosophie et la sémiotique de la circulation de l’information et du sens en ligne, il a travaillé à Paris pour le quotidien en ligne Reporterre ainsi que dans des projets lancés par Bernard Stiegler. Il mène actuellement ses recherches pour son mémoire à l'Institute of Network Cultures, théorisant et expérimentant de nouvelles possibilités pour le « texte social » - un potentiel accru par l’écriture numérique, au travers de pratiques telles que l’annotation web, l’écriture collaborative et l’intervention dans les métadonnées des contenus. Il est membre fondateur et vice-président de l'Association des Amis de la Génération Thunberg (AAGT), dont il est en charge (et contributeur régulier) du blog sur Mediapart.
Merci à Esther Haberland, Giuseppe Longo, Somhack Limphakdy et Jordi Viader pour leurs apports, ainsi que Geert Lovink, Chloë Arkenbout et Kate Babin pour leur relecture de ce texte à l'INC. De nombreuses références de la partie "régime et récit techno-magique" m'ont été partagées par Igor Galligo, et certaines références cruciales de la partie "lecture et écriture numériques" sont issues de séminaires co-organisés par Anne Alombert. La traduction en anglais a été facilitée par le traducteur DeepL.
—
Références
Serge Abiteboul et Jean Cattan, Nous sommes les réseaux sociaux, Paris : éditions Odile Jacob, 2022.
Franco Bifo Berardi, The Third Unconscious, Londres : Verso Books, 2021.
Yves Citton et Frédéric Lordon, Spinoza et les sciences sociales. De la puissance de la multitude à l’économie des affects, Paris : éditions Amsterdam éditions, 2008.
Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris : Les Éditions de Minuit, 1991.
Gilles Deleuze et Félix Guattari, L’Anti-Oedipes, Paris : Les Éditions de Minuit, 1972.
Jean Lassègue, ‘Sur la construction collective des signes : l’Ancien Régime et la révolution’ in Anne Alombert, Victor Chaix, Maël Montévil et Vincent Puig (eds) Prendre Soin de l’Informatique et des Générations. Hommage à Bernard Stiegler, Limoges : FYP éditions, 2021.
Lawrence Lessig, Code And Other Laws Of Cyberspace, New York : Basic Books, 1999.
Geert Lovink, Extinction Internet, Amsterdam : Institute of Network Cultures, 2022. https://networkcultures.org/blog/publication/extinction-internet/
Geert Lovink, Stuck on the Platform. Reclaiming the Internet, Amsterdam : Valiz, 2022.
Georges Monbiot, Out of the Wreckage. A New Politics for an Age of Crisis, Londres : Verso Books, 2017.
Friedrich Nietzche, Ainsi Parlait Zarathoustra, Paris : Librairie générale française, 1972.
Claudio Paolucci, Strutturalismo e Interpretazione, Milan : Studi Bompiani, 2010.
Brice Roy, Penser le jeu à l’ère du numérique : une approche à la croisée de la phénoménologie et de la théorie des supports, Compiègne : Université de Technologie de Compiègne, 2019. https://theses.hal.science/tel-03119573/document
Bernard Stiegler, Aimer, s’aimer, nous aimer, Paris : Éditions Galilées, 2003.
Vincenzo Susca, Tecnomagia. Estasi, Totem e Incantesimi Nella Cultura Digitale, Milan : Mimesis Edizioni, 2022.
Marcelo Vitali-Rosati, On Editorialization. Structuring Space and Authority in the Digital Age, Amsterdam : Institute of Network Cultures, 2018. https://networkcultures.org/blog/publication/tod-26-on-editorialization-structuring-space-and-authority-in-the-digital-age/

